EN BREF – À Grenoble, des chercheurs viennent de montrer que la maladie de Huntington dont les symptômes apparaissent à l’âge adulte est liée à un manque précoce, dès le stade embryonnaire, de protéines NUMA1. Le cortex est touché mais pas seulement, l’équipe grenobloise ayant également démontré l’origine développementale de cette autre caractéristique de la maladie : le rétrécissement du corps calleux.
On commence à y voir plus clair dans les événements et les mécanismes silencieux qui contribuent à l’apparition des symptômes de la maladie génétique, actuellement incurable, de Huntington1Rangée dans les pathologies génétiques rares du système nerveux central, la maladie de Huntington est causée par une mutation du gène codant pour la protéine huntingtine. La prévalence de la maladie est d’environ 5 cas pour 100 000 individus. Ainsi, en France, la maladie concerne environ 18 000 personnes dont 6 000 présentent déjà des symptômes et près de 12 000 portent le gène muté mais sont encore asymptomatiques. Cette affection se caractérise par une perte de cellules nerveuses en particulier dans la région du striatum, une zone cérébrale intervenant dans le contrôle des mouvements volontaires ainsi que dans certains processus comportementaux et cognitifs. D’où l’apparition de troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques qui s’aggravent progressivement jusqu’à la grabatisation et la détérioration intellectuelle sévère. Le décès survient en moyenne vingt ans après le début des symptômes. grâce aux travaux de chercheurs grenoblois de l’Institut des neurosciences de Grenoble (Gin), dirigés par Sandrine Humbert.
Ainsi, les scientifiques grenoblois ont récemment montré que les évènements neurodégénératifs survenant dans le cortex2La substance grise périphérique des deux hémisphères cérébraux débutent chez les patients dès le stade embryonnaire. Et ce, même si les symptômes apparaissent généralement entre 30 et 50 ans. Le tout, à cause notamment d’un problème affectant la division des cellules souches à l’origine des cellules nerveuses ou neurones.

Corps calleux (représenté en rouge) constitué d’axones de neurones issus des deux hémisphères du cortex. DR
En poursuivant ses travaux, l’équipe vient de découvrir que l’amincissement du corps calleux3Structure de couleur blanche faisant le pont entre les deux hémisphères du cortex et composée d’axones myélinisés (et donc blancs) issus de neurones localisés dans ces deux hémisphères, une autre caractéristique de la maladie de Huntington, découle aussi, au moins pour partie, de défauts dans le développement cérébral. Et qu’une protéine nommée NUMA1 est impliquée dans ces deux phénomènes. Cette avancée est telle que Sandrine Humbert se prend à espérer qu’« à terme nous trouverons des moyens d’enrayer la progression de la maladie pour éviter − ou au moins retarder − la survenue des symptômes ». Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la revue Neuron le 7 novembre 2021.
Les axones poussent moins bien à cause d’un manque de NUMA1
Plus précisément, les chercheurs ont constaté dans le corps calleux de souris génétiquement modifiées afin de modéliser fidèlement la maladie de Huntington humaine, une altération de la croissance des plus grands prolongements des neurones appelés axones. « En situation normale, le “cône de croissance”, cette structure en forme de palme située à l’extrémité des axones, étire ces prolongements vers leur future cible », expliquent les chercheurs. Or, « chez les porteurs de la maladie, les axones “poussent” moins bien ».

Cytosquelette des neurones marqué par fluorescence (en vert). DR
En cause, d’après les résultats, un important déficit en protéines NUMA1 qui altère l’architecture de ces cônes. Le manque de NUMA1 conduit en effet au relâchement et à la désorganisation du cytosquelette4Squelette interne des cellules sans lequel cette croissance est impossible. De même, la bonne marche de la division cellulaire dépend-elle aussi de ce même cytosquelette.
Le blocage d’une molécule régulatrice rétablit la production de NUMA1
Comment s’explique ce déficit en NUMA1 ? Les chercheurs ont découvert qu’il est lié à la surexpression d’une molécule régulatrice de la famille des acides nucléiques nommée microARN miR124, empêchant la synthèse de la protéine. De fait, en bloquant l’activité de ce microARN, les chercheurs ont bel et bien réussi à rétablir la production de NUMA1 chez les souris malades, ainsi que la formation d’un corps calleux normal.
Le début d’une piste thérapeutique ? Une chose est sûre, reste encore à comprendre le lien entre la mutation du gène de la huntingtine, responsable de la maladie, et cette surexpression de miR124. Ce à quoi travaille d’ores et déjà d’arrache-pied l’équipe grenobloise.






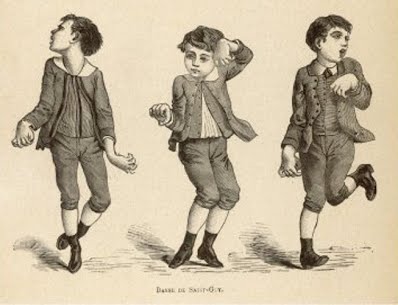









Une réflexion sur « Maladie neurodégénérative de Huntington : des chercheurs grenoblois ont découvert l’origine des défauts de croissance des neurones »
Bonjour
Je souhaite si possible etre informé sur les évolutions des thérapies concernant la maladie de Huntington
Une personne de ma famille en étant atteinte dernièrement
Merci