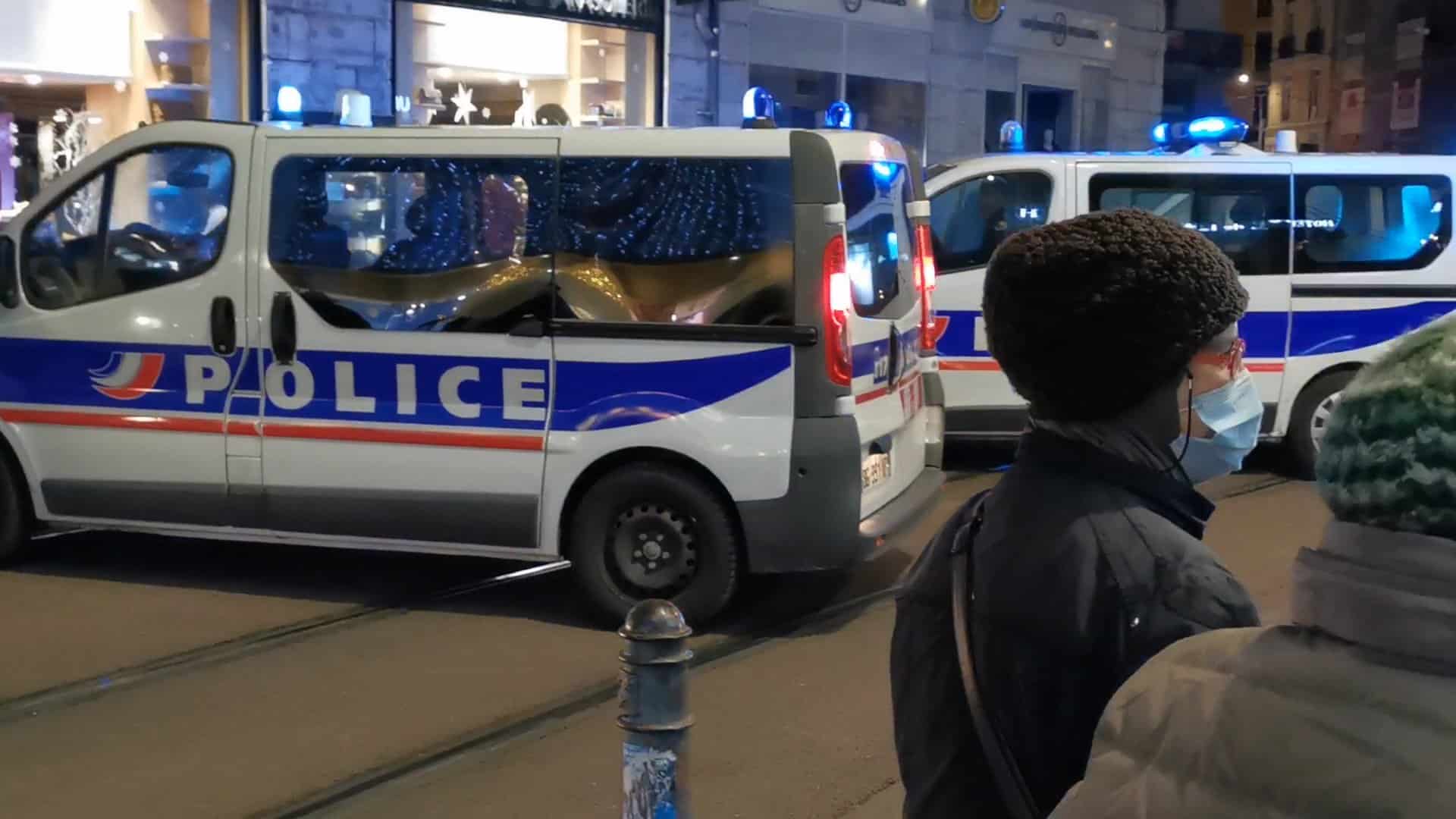DÉCRYPTAGE – Alors que les nanomatériaux continuent d’inonder le marché, on ne sait pas grand-chose quant à leur impact sur la santé et l’environnement. Pas plus contrôlés que les produits conventionnels, les nanos jouent les électrons libres. Faute de cadre législatif, la recherche avance à tâtons. Pour tenter d’y voir plus clair et accompagner le développement des nanotechnologies, Grenoble s’est dotée d’une plate-forme dédiée à la nanosécurité.

Inauguration de la plate-forme nanosécurité du CEA à Grenoble © Patricia Cerinsek / placegrenet.fr

Recherche, expertise, mesure, formation mais aussi intervention en cas d’accident font partie des missions de la plate-forme nanosécurité grenobloise, inaugurée par la ministre Geneviève Fioraso. © Patricia Cerinsek / Place Gre’net

La sécurité et la protection des salariés sont au cœur des préoccupations. Mais quid des consommateurs derrière ? © Patricia Cerinsek / Place Gre’net

Inauguration de la plateforme nanosécurité du CEA à Grenoble.

La PNS, ce sont aussi des équipements spécialisés. Ainsi, Equipex NanoID est capable de détecter et d’identifier les nanoparticules. © Patricia Cerinsek / Place Gre’net
* 14,3 millions d’euros de la Région et trois millions d’euros de l’État dans le cadre du plan Campus “Grenoble université de l’innovation”. A quoi il faut ajouter 15,2 millions d’euros d’équipements et de matériels spécialisés, dont l’équipement d’excellence NanoID (10,2 millions d’euros), capable de détecter et d’identifier les nanoparticules.