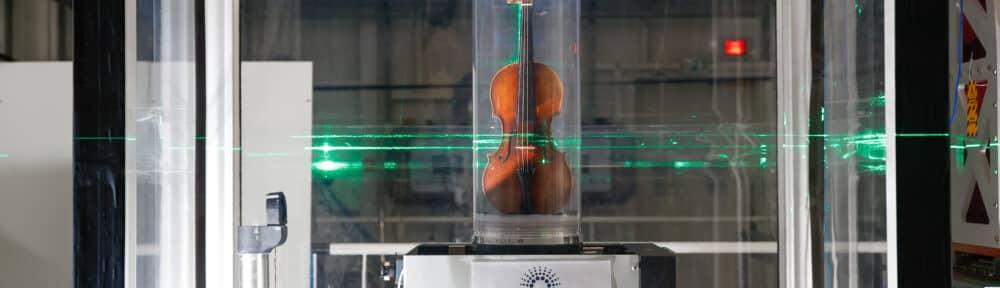FOCUS – Le glacier de l’Île du Pin, l’un des plus grands de l’Antarctique, a perdu en moyenne 20 milliards de tonnes de glace par an et reculé d’environ dix kilomètres sur une dizaine d’années. Des chercheurs grenoblois associés à diverses équipes internationales ont réussi à modéliser précisément cette fonte accélérée qui pourrait entraîner une augmentation très significative du niveau des mers.
C’est une étape majeure qui vient d’être franchie par les chercheurs du Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement (LGGE)*. En réussissant à modéliser de manière très rigoureuse la fonte du glacier de l’Île du Pin en Antarctique, ils viennent d’apporter une pierre majeure à l’édifice de la connaissance scientifique pour mieux comprendre ce phénomène.
Gaël Durand, chercheur au Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement (LGGE). DR

Vitesse de déplacement de la surface du glacier. La vitesse croît du bleu au rouge.

Gaël Durand. DR

Déplacement de la ligne d’échouage.
Image Modis, National Snow and Ice Data Center, Université du Colorado, Boulder, US.

Le LGGE. DR